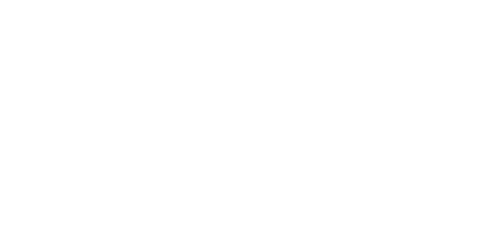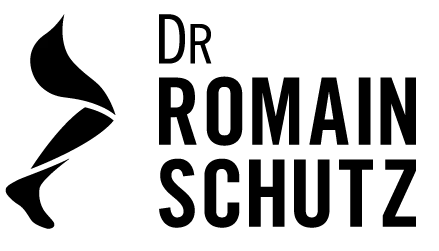La prothèse totale de hanche
De quoi est constitué une prothèse de hanche ?
La prothèse totale de hanche est constituée d’un implant fémoral qui s’articule avec un implant cotyloïdien par l’intermédiaire d’une tête prothétique.
L’implant fémoral est composé d’alliage de différents métaux. Il existe différentes formes et longueurs de tige fémorale qui sont choisies selon l’anatomie et la qualité osseuse du patient. Son implantation dans le fémur peut se faire à l’aide d’un ciment spécifique, ou bien sans ciment. Dans ce dernier cas, la tige comporte un revêtement de surface en hydroxyapatite, un composant du tissu osseux humain, lui permettant une parfaite intégration au fémur à l’image d’une greffe.
Chez un patient présentant une anatomie dite standard, le chirurgien utilise préférentiellement une tige fémorale « anatomique » lui permettant d’épouser au plus près les parois du fémur.
Lorsqu’il existe une bonne qualité osseuse, notamment chez un patient jeune, la tige fémorale employée peut être courte afin de préserver le stock osseux. Elle sera le plus souvent implantée sans ciment.
Lorsque le patient présente une déformation osseuse particulière, ou lorsque la qualité osseuse est précaire, voire dans les cas de révisions prothétiques, le chirurgien est amené à utiliser un implant fémoral qui prend appui sur une plus grande surface osseuse : il s’agit d’une tige longue qui est fixée à l’os à l’aide de ciment ou bien impactée dans le fémur puis verrouillée par des clavettes.
L’implant cotyloïdien est composé d’une cupule métallique qui est mise en place dans le cotyle de l’os iliaque par impaction lorsque l’implant est dit « sans ciment », ou bien scellée dans l’os à l’aide de ciment acrylique.
Lorsque le cotyle présente une dysplasie osseuse, ou que la qualité osseuse est précaire, on utilise parfois une cupule cotyloïdienne spécifique comportant des éléments de fixation osseux supplémentaires tels que des vis métalliques ou des crochets de fixation.

Dans les cas de révision prothétique, on utilise une armature de soutien qui s’implante dans l’os iliaque à l’aide de vis multiples et permet la mise en place de la cupule cotyloïdienne en bonne position.
La cupule s’articule avec la tige fémorale par le biais d’une tête prothétique et d’un insert créant une interface. La composition de ces éléments dit « couple de frottement » est choisie par le chirurgien selon l’âge du patient et sa demande fonctionnelle.
Le couple céramique-céramique a la durée de vie la plus longue et est implanté chez des sujets âgés de moins de 70 ans. Le couple métal-polyéthylène a une usure un peu plus rapide que la céramique. En revanche, l’implant métal-polyéthylène « double-mobilité » présente deux articulations en un seul implant et a ainsi l’avantage d’avoir un effet anti-luxation de prothèse. Il est préconisé chez les patients de plus de 75 ans ou dans le cas de facteurs de risque d’instabilité prothétique comme certaines maladies neurologiques.
En quoi consiste la mise en place d’une prothèse de hanche ?
L’arthroplastie totale de hanche est une intervention chirurgicale qui consiste à remplacer l’articulation de la hanche endommagée par des lésions d’arthrose évoluées, par un implant articulaire prothétique.
Il existe différents types de prothèse de hanche, variant essentiellement selon les constituants de l’articulation prothétique, dit « couple de frottement », et selon le mode de fixation des implants à l’os.
Il existe différentes techniques chirurgicales permettant d’accéder à l’articulation de la hanche afin de mettre en place la prothèse de hanche : il s’agit des voies d’abord de hanche dont les muscles concernés sont directement en lien avec la récupération fonctionnelle de la mobilité articulaire après l’intervention chirurgicale.

Comment se déroule une arthroplastie totale de hanche ?
L’intervention chirurgicale a lieu le plus souvent sous anesthésie générale. Elle consiste à remplacer les éléments de l’articulation de la hanche par un implant prothétique en 2 parties, la tige fémorale et l’implant cotyloïdien.
L’articulation de la hanche est atteinte par voie d’abord postérieure ou antérieure de hanche.
Le premier temps de l’opération consiste à mettre en place l’implant cotyloïdien. Celui-ci est positionné dans le cotyle de l’os iliaque après préparation de son emplacement par fraisage osseux de diamètre croissant jusqu’à obtention d’un maintien osseux parfait de l’implant dans la cavité cotyloïdienne.
Le deuxième temps de l’opération consiste à implanter la tige fémorale dans le fémur. Celle-ci est mise en place après coupe osseuse du col du fémur et extraction de la tête fémorale endommagée par l’arthrose. Le fémur est préparé à l’aide de râpes de taille croissante jusqu’à obtention d’un maintien osseux parfait de l’implant dans le fût fémoral. Des implants d’essai fémoral et cotyloïdien permettent de tester en cours d’intervention la bonne stabilité de la hanche ainsi que la parfaite restauration des paramètres anatomiques tels que la longueur du membre inférieur opéré.

Les implants définitifs sont alors mis en place et la fermeture des différents plans anatomiques est réalisée. Lorsqu’une voie d’abord postérieure de hanche est réalisée, les muscles pelvitrochantériens sont refixés au fémur à l’aide de fils de suture. Une attelle d’immobilisation est alors mise en place pendant quelques jours après l’intervention afin de protéger la cicatrisation musculaire postérieure de hanche.
La durée d’intervention est d’environ une heure.
Comment accède-t-on à l’articulation de la hanche ?
En chirurgie, la voie d’abord est le chemin emprunté par le chirurgien pour atteindre une structure profonde telle qu’une articulation.
Il existe 2 voies d’abord classiques permettant d’atteindre l’articulation de la hanche lors de l’implantation d’une prothèse de hanche.
La voie d’abord postérieure consiste à atteindre l’articulation de la hanche en passant en arrière du fémur. Elle nécessite de sectionner les muscles pelvitrochantériens de la hanche, qui sont réinsérés au fémur en fin d’intervention. Cette voie d’abord est employée lors de certaines déformations anatomiques telles que la dysplasie de hanche en coxa vara, chez des patients en surpoids ou avec une forte musculature de hanche. On emploie la voie d’abord postérieure de hanche dans les cas complexes et les révisions prothétiques.
Dans de rares cas d’arthrose évoluée avec ankylose de la hanche, c’est-à-dire fusion de l’articulation, il est nécessaire de pratiquer une coupe du trochanter, partie du fémur sur laquelle s’insère les muscles fessiers. Il s’agit de la trochantérotomie. Le trochanter est refixé en fin d’intervention au fémur à l’aide de fils métalliques et parfois à l’aide d’un crochet de fixation.
La voie d’abord antérieure consiste à atteindre l’articulation de la hanche en passant en avant du fémur entre le muscle tenseur du fascia lata et les muscles fessiers. Cette voie d’abord ne sectionne aucun muscle et l’articulation est atteinte en réclinant les plans musculaires sans les endommager. Cette voie d’abord confère à la prothèse de hanche un risque très faible de luxation d’implants. Elle est particulièrement adaptée aux patients de corpulence mince, avec musculature de hanche de trophicité normale, ou bien présentant une dysplasie de fémur en coxa valga.
Quelles sont les suites opératoires d’une arthroplastie de hanche ?
La mise en place d’une prothèse de hanche nécessite un court séjour à la clinique d’un à trois jours selon l’état général du patient et ses comorbidités.
Après une arthroplastie totale de hanche par voie d’abord postérieure, la mise en place d’une attelle de genou en extension est nécessaire pendant quelques jours afin de protéger la cicatrisation musculaire postérieure de hanche et prévenir le risque de luxation prothétique. La voie d’abord antérieure ne nécessite aucune immobilisation postopératoire.
Une radiographie de contrôle de la hanche opérée est réalisée le jour de l’intervention afin de s’assurer du bon positionnement des implants prothétiques avant la mise en charge du patient.
L’appui sur le membre opéré est immédiat et complet quel que soit la voie d’abord chirurgicale de hanche.
Le kinésithérapeute aide le patient à se verticaliser dès le jour de l’opération et l’encourage à marcher à l’aide de cannes béquilles. Il apprend au patient à éviter les manœuvres à risque de luxation prothétique.
Les soins de cicatrice et de pansement sont débutés à la clinique puis réalisés à domicile ou en structure médicalisée de rééducation après la sortie du patient.

Un traitement antalgique est administré et un médicament anticoagulant est également prescrit afin de prévenir le risque de phlébite post-opératoire.
La rééducation est poursuivie selon un protocole spécifique à la sortie du patient de la clinique. Elle vise à obtenir une récupération fonctionnelle de la mobilité articulaire de la hanche opérée à 6 semaines de l’intervention chirurgicale. Un suivi médical a lieu de manière rapproché les mois suivants l’intervention puis tous les ans avec réalisation de radiographies de contrôle de hanche afin de s’assurer de l’absence de descellement prothétique de hanche.