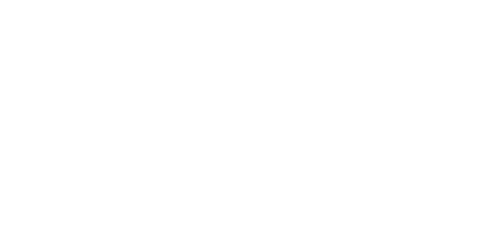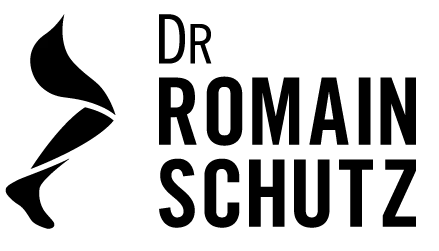Les lésions méniscales du genou
À quoi correspond une lésion méniscale du genou ?
L’articulation du genou est constituée de 2 ménisques, le ménisque interne et le ménisque externe. Les ménisques sont des structures fibreuses jouant un rôle d’amortisseur et de stabilisateur des surfaces articulaires du fémur et du tibia l’une contre l’autre. Ils sont répartis en 3 segments antérieur, moyen et postérieur de l’avant vers l’arrière du genou. Ils sont fixés en avant et en arrière du tibia par les « racines méniscales ».
Le ménisque interne est solidement fixé au ligament collatéral médial du genou et aux tissus mous postérieurs du genou appelés « rampe méniscale ». Le ménisque externe est plus mobile que le ménisque interne lors des mouvements du genou. Les ménisques sont vascularisés et innervés par leurs attaches périphériques au niveau du « mur méniscal ». Ils freinent l’usure du cartilage de l’articulation du genou. Ils sont sollicités en permanence lors des mouvements usuels du genou.
Certains mouvements tels que l’hyperflexion du genou lors de l’accroupissement et la rotation du tibia en appui, mettent les ménisques en contrainte. Lorsque le genou présente une laxité au cours d’une entorse du ligament croisé antérieur, les ménisques peuvent également être lésés. Les lésions méniscales peuvent être décrites selon une direction horizontale ou verticale dans le tissu méniscal. Les lésions méniscales peuvent cicatriser différemment en fonction de l’atteinte méniscale interne ou externe, de la localisation plus ou moins proche du mur méniscal et du degré d’instabilité de la lésion.
Quelles sont les causes d’une lésion méniscale du genou ?
Les lésions méniscales peuvent être soit d’origine traumatique, secondaires à un mouvement brutal du genou en hyperflexion et rotation, en appui. Elles surviennent alors fréquemment chez un patient jeune au cours d’un accident sportif ou de loisir (football, tennis, danse). Le mécanisme causal est fréquemment à l’origine de lésions ligamentaires associées telles qu’une entorse du ligament croisé antérieur.
Elles peuvent également être d’origine dégénérative, c’est-à-dire secondaire à l’usure naturelle des ménisques. Elles se manifestent à l’occasion de mouvements bénins en appui, pivot et flexion de l’articulation du genou. Elles surviennent à un âge plus avancé et sont parfois concomitantes de l’apparition de lésions cartilagineuses d’arthrose débutante du genou.
« Mon genou s’est bloqué brutalement lorsque je me suis relevé de la position accroupie »
Lucien 45 ans
Travailleur du BTPComment se manifeste une lésion méniscale du genou ?
Lorsque la lésion méniscale est d’origine traumatique, le patient présente des douleurs aiguës du genou augmentées par la mobilisation articulaire. L’articulation est parfois gonflée voire même bloquée en cas de lésion méniscale instable de type « anse de seau ». Il peut également ressentir une instabilité du genou avec sensation de dérobement lors de certains mouvements, en particulier lorsque la lésion méniscale accompagne une entorse du ligament croisé antérieur.
Lorsque la lésion méniscale est d’origine dégénérative, le patient se plaint de douleurs chroniques du genou évoluant par crises douloureuses exacerbées par certains mouvements articulaires. Il existe alors un retentissement fonctionnel marqué dans les déplacements de la vie quotidienne et les activités professionnelles, sportives et de loisirs.
Comment diagnostique-t-on une lésion méniscale du genou ?
La lésion méniscale est suspectée devant une douleur vive à la palpation de l’interligne fémoro-tibial interne ou externe, appelé « cri méniscal ». Certaines manœuvres cliniques telles que le test de McMurray provoquent un cisaillement du ménisque à l’origine d’une douleur en cas de lésion.
Une IRM du genou est réalisée afin de confirmer la lésion méniscale et de préciser le caractère traumatique ou dégénératif de la lésion. Elle précise le segment méniscal touché par la lésion, son étendue, son type vertical, horizontale ou mixte, l’atteinte d’une racine ou d’une rampe méniscale, la présence d’une « anse de seau » méniscale ou d’une languette méniscale. Elle révèle également des lésions associées du ligament croisé antérieur, voire des ligaments collatéraux latéraux ou médiaux et précise la présence d’une lésion cartilagineuse associée.
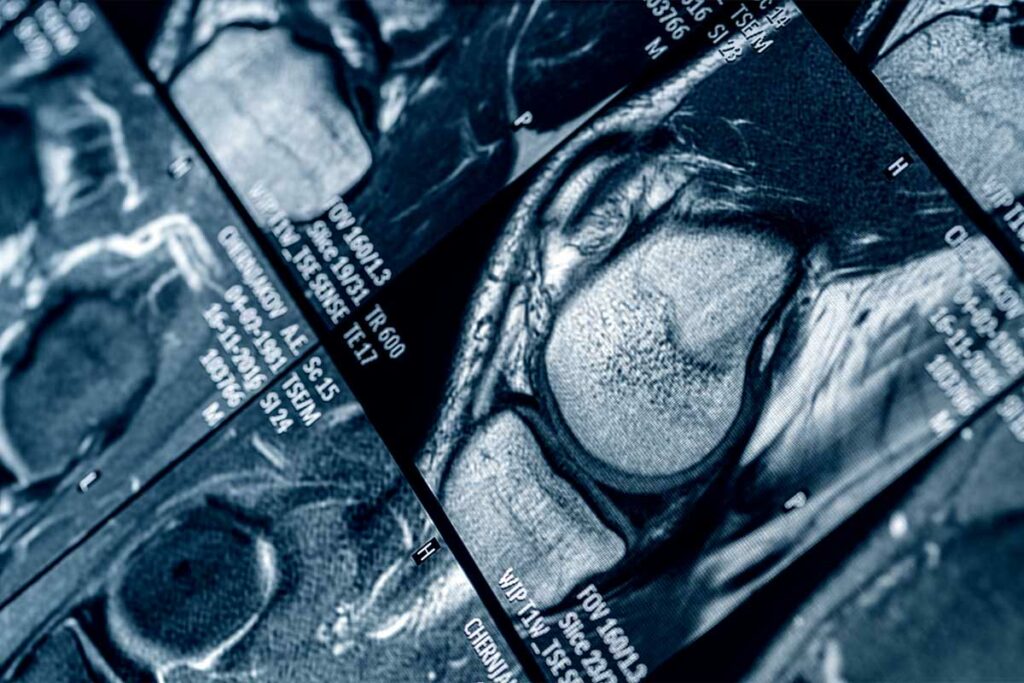
Des radiographies debout dites « en charge » et réalisées en incidence semi-fléchie dite « schuss » sont pratiquées afin de dépister une arthrose du genou sous-jacente, en particulier chez un patient d’âge avancé. Un cliché radiographique dit télémétrie doit également être réalisé afin de dépister une désaxation du genou en varus ou valgus, favorisant l’usure dégénérative articulaire, méniscale et cartilagineuse.
Comment soigne-t-on une lésion méniscale du genou ?
Le traitement d’une lésion méniscale repose dans un premier temps sur des médicaments antalgiques et anti-inflammatoires non stéroïdiens associés à une immobilisation de courte durée à visée antalgique.
En cas de lésion méniscale de nature traumatique, instable, de type anse de seau méniscale ou languette méniscale, entraînant un blocage brutal du genou, le traitement proposé peut être chirurgical d’emblée. En effet, seule la réduction chirurgicale de la lésion peut permettre de redonner une pleine mobilité à l’articulation. L’intervention est réalisée sous arthroscopie du genou, c’est-à-dire par le biais de petites incisions en regard de l’articulation, permettant d’introduire une caméra optique et des instruments spécifiques dans l’articulation. Elle consiste à réaliser une suture méniscale dans la plupart des cas, ou une régularisation de la surface du ménisque en cas de languette instable.
En cas de lésion méniscale de nature traumatique stable, c’est-à-dire entraînant des douleurs du genou sans altération de la mobilité articulaire, le traitement fonctionnel reposant sur des séances de rééducation spécifique est mis en place.
La rééducation est axée sur l’entretien voire la récupération des mobilités articulaires, ainsi que le renforcement des muscles autour du genou dont le muscle quadriceps. Une éducation est engagée visant à expliquer les mouvements à risque de lésions méniscales. Cette séquence favorise la cicatrisation spontanée de la lésion méniscale. Une infiltration de corticoïdes au contact du mur méniscal réalisée sous échographie du genou peut parfois améliorer la cicatrisation méniscale.
Lorsque les douleurs du genou persistent malgré la rééducation, une intervention chirurgicale est proposée. Elle consiste à réaliser un geste de stabilisation méniscale sous arthroscopie du genou, de type suture méniscale dans la plupart des cas, afin de conserver le capital méniscal. Parfois, il est nécessaire de retirer une partie la plus économe possible du ménisque : on parle de méniscectomie partielle. Les lésions des rampes et des racines méniscales doivent également être stabilisées par suture ou réinsertion méniscale. Lorsqu’une lésion associée a été identifiée, telle qu’une rupture du ligament croisé antérieur, il est nécessaire d’envisager une reconstruction du ligament croisé antérieur par ligamentoplastie. Ce geste chirurgical est réalisé au cours de la même intervention et stabilise le genou permettant ainsi la cicatrisation méniscale.
En cas de lésion méniscale d’allure dégénérative, et en particulier, lorsqu’une arthrose du genou sous-jacente a été identifiée, un traitement fonctionnel par rééducation est engagé pendant plusieurs mois dans le but de préserver les ménisques et d’éviter l’apparition d’une arthrose fulgurante du genou pouvant faire suite à une méniscectomie. En cas d’échec de cette attitude bien conduite pendant 6 mois minimum, une intervention chirurgicale consistant à réaliser une méniscectomie partielle sous arthroscopie du genou, sera envisagée. Au cours de la même intervention, des lésions associées freinant la cicatrisation méniscale doivent être traitées telles qu’une rupture du ligament croisé antérieur ou une désaxation du genou en genu varum ou genu valgum.